Point limite zéro
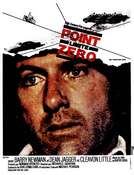
| Titre original: | Point limite zéro |
| Réalisateur: | Richard C. Sarafian |
| Sortie: | Cinéma |
| Durée: | 98 minutes |
| Date: | 12 mai 1971 |
| Note: |
Critique de Tootpadu
Deux ans après l'oeuvre charnière de Dennis Hopper, deux films très semblables sortaient sur les écrans américains qui détournaient chacun cette course à travers le pays à des fins plus abstraites. Comme Macadam à deux voies de Monte Hellman, Point limite zéro, qui se nomme plus poétiquement "Vanishing Point" en anglais, présente une vision particulière de la vitesse. Le protagoniste et anti-héros par excellence Kowalski franchit certes une limite d'état après l'autre, laissant derrière lui les voitures de police dans d'immenses nuages de poussière, mais la raison pour cette course effrénée n'est jamais révelée. Le but apparent de son trajet est connu, mais quant à la raison pour son empressement déraisonnable, aucune hypothèse ne peut être écartée. L'interprétation qu'en fait le présentateur de radio, tel un choeur antique, n'est qu'une façon de voir les choses. D'ailleurs, ses commentaires nous ont rappelé ceux du clochard dans Bulworth, qui décèle avec autant de lucidité que Super Soul les dangers imminents de l'acte d'acrobatie du personnage principal désespéré pour des raisons diverses.
L'absence de justification pour l'intrigue ne freine cependant pas Richard C. Sarafian à créer un cocktail explosif et beau qui opère un tour d'horizon efficace de la société américaine. Les rencontres de Kowalski sont plutôt rares, mais elles traitent toutes, plus ou moins détendues et politiquement incorrectes, des préoccupations de l'époque. Entre une jolie fille qui se promène nue sur sa moto et deux homosexuels caricaturaux, la conscience afro-américaine se fait tabasser par une bande de ploucs et Kowalski opère son périple sans états d'âme. La frénésie qui monte autour de lui et qui le laisse grandement indifférent revient brutalement à la sobriété lors d'une fin qui n'est pas moins énigmatique que l'ensemble du film.
Comme il se doit pour un film issu d'une époque musicalement foisonnante, la bande originale est de premier choix. De même, la distribution puise sa force d'un éclectisme surprenant. C'est surtout le trop rare Cleavon Little dans le rôle de Super Soul qui approfondit encore l'étrange spiritualité d'un film dont l'appartenance au genre du road-movie n'est peut-être que façade.
Vu le 1er avril 2006, à l'Espace Saint-Michel, Salle 2, en VO
Note de Tootpadu:

