Sang du châtiment (Le)
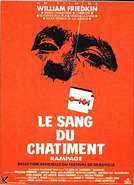
| Titre original: | Sang du châtiment (Le) |
| Réalisateur: | William Friedkin |
| Sortie: | Cinéma |
| Durée: | 96 minutes |
| Date: | 23 novembre 1988 |
| Note: |
Critique de Tootpadu
William Friedkin, le symbole d'un certain pan du cinéma américain des années 1970, ne doit pas avoir des souvenirs très positifs de cette période qui a vu décliner sa carrière vers les bas-fonds du cinéma de genre dans lesquels il patauge jusqu'à ce jour. Après son fiasco personnel le plus controversé et le plus mal aimé de toute sa filmographie (Cruising), seul son Police fédérale, Los Angeles a su redorer temporairement son blason. Ce film-ci, au mieux un précurseur très maladroit du Silence des agneaux, a même connu un tel chaos légal et financier qu'il n'est sorti aux Etats-Unis que quatre ans après sa réalisation. Entre-temps, Friedkin avait apparemment changé d'avis sur la peine de mort et s'était empressé de bidouiller la fin pour refléter sa nouvelle position.
Nous doutons fortement que cette fin alternative change de façon essentielle le propos peu clair du film. Faute de pouvoir susciter la moindre émotion pour les victimes, l'assassin ou le procureur tourmenté, Friedkin s'emploie à tomber dans un piège tendancieux après l'autre, jusqu'à se fourvoyer dans les pires rapprochements imaginables (la comparaison de Fraser entre les atrocités des nazis et la quête sanguinaire de l'accusé). De cette absence pure et simple d'un point de vue déterminé et d'une visée autre que la plus clichetonneuse et grotesque, de ce flou du fond en somme, notre conviction que Friedkin est un cinéaste sans la moindre épaisseur thématique sort une fois de plus confirmée.
Si l'expression d'un agenda personnel probablement réactionnaire est ainsi très molle, le maniement du vocabulaire filmique est carrément désastreux et beaucoup moins discret. Le Sang du châtiment fait ainsi partie des films risibles où l'on soupçonne sans peine les intentions du réalisateur, mais dans lesquels ces dernières ne se matérialisent jamais à l'écran. La lourdeur du trait devient par conséquent presque divertissante, tellement la mise en scène tente maladroitement de duper le spectateur avec ses très grosses ficelles. Les seules surprises du scénario bancal surviennent, lorsque la prévisibilité est encore surpassée par des excès formels ahurissants. Que ce soit le plan récurrent de Reece qui se met du sang sur tout le corps devant une cage de fauves, ou les ralentis écoeurants chaque fois qu'un retour en arrière tente vainement d'établir un lien entre l'enquête et la mort accidentelle de la fille de Fraser, les occasions ne manquent pas pour s'étonner du mauvais goût de Friedkin. Du reste, les éléments de base de la narration filmique, qui implique le maintien d'un rythme minimal, et de la composition du plan, qui incite à des cadrages plus élaborés que ceux d'un feuilleton de télé bâclé, ne paraissent guère préoccuper le réalisateur.
Enfin, il existe un petit détail dans ce désordre aussi frustrant que méchamment divertissant qui mérite un peu d'attention : la bande originale d'Ennio Morricone. Loin de compter parmi ses meilleures compositions, elle instaure au moins une atmosphère inquiétante et oppressante qui serait autrement absente de cette bouse faite avec des bouts de ficelle (la salle d'audience pitoyable).
Vu le 16 avril 2006, à la Cinémathèque Française, Salle Henri Langlois, en VO (montage international)
Note de Tootpadu:

